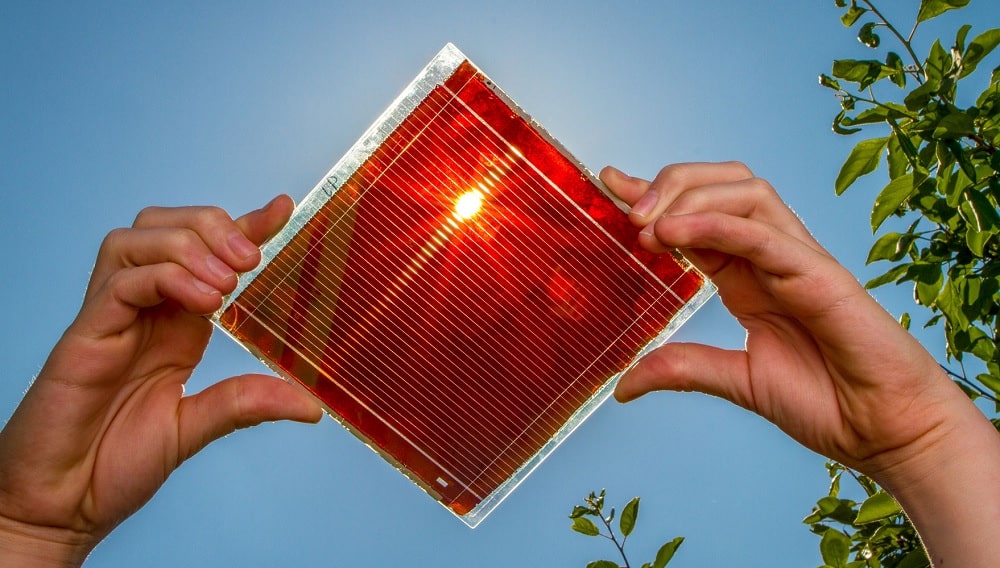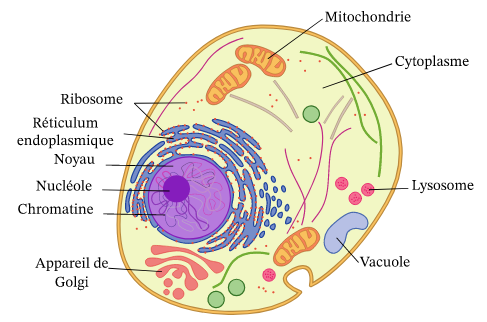Lorsque Darwin revient de son long voyage sur le HMS Beagle, qui a duré environ 5 ans, sa vie est profondément transformée. Et spécialement sa manière de penser et de voir le monde dans lequel il évolue. Quelques années après son retour, en 1859, il publie le texte qui le rendra célèbre : « L’Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie».
Pour nous, Darwin est comme le père de l’évolution. Pourtant, d’après ce que j’en comprends le mot « évolution » n’apparaît pas dans cet écrit, du moins pas dans la première version. Et l’idée même d’évolution est encore très primitive. Mais Darwin en ouvre la voie en faisant éclater deux conceptions qui étaient considérées à l’époque comme des absolus.
Le premier bouleversement concerne la mise en cause du fixisme. À l’époque de Darwin, il ne vient à l’esprit de personne, ou presque, que le monde puisse changer. L’univers est ce qu’il a toujours été. Et, dans le cas qui nous concerne, les espèces vivantes sont ce qu’elles ont toujours été. Un cheval engendre un cheval et un mouton engendre un mouton. Et celui depuis la nuit des temps. Même si, 50 ans plus tôt, Jean Baptiste Lamark avait déjà proposé une théorie de transformisme et d’une nécessaire évolution des espèces.
Cette conception, appelée fixisme, n’est pas seulement liée au récit biblique de la création du monde où il est affirmé que Dieu a créé les animaux et les bestiaux, les oiseaux et les poissons, et aussi les plantes, « chacun selon son espèce ». Dans toutes les traditions religieuses, des mythes racontent les commencements d’un monde qui, par la suite, demeure fidèle à lui-même, toujours le même, fixement, année après année. Et ceux qui sont les plus solidement ancrés dans le « fixisme », ce sont les scientifiques eux-mêmes. L’univers est ce qu’il a toujours été. Sinon, la science s’écroule. Si les choses changent, comment peut-on en tirer des lois constantes et universelles ?
En proposant sa thèse sur « L’origine des espèces », Darwin suppose que les choses peuvent changer. Il remet en cause le « fixisme ». Pour le moment, cela ne concerne que les êtres vivants. Il faudra encore plusieurs décennies avant que le fixisme ne tombe à tous les niveaux dans l’univers et dans les sciences. Mais si l’univers n’est pas fixe, alors, sur quoi la science va-t-elle pouvoir s’appuyer ?
Darwin ne répond évidemment pas à cette question. D’ailleurs, il mourra sans avoir pu répondre à la question de savoir comment il se fait que les espèces se transforment. Il va cependant proposer un autre concept qui aura beaucoup d’influence par la suite : la « sélection naturelle ».
Darwin crée ce concept de « sélection naturelle » à partir de ce que font les éleveurs autour de lui. Spontanément, ils choisissent les bêtes les plus fortes pour les faire accoupler, dans l’espoir que cela donnera une nouvelle génération plus forte. Et cela semble fonctionner.
Darwin, partant de cette observation, propose le concept de « sélection naturelle ». Les choses se passent comme si « la nature » agissait par elle-même à la manière d’un éleveur. En proposant ce concept, Darwin ouvre la voie à une toute nouvelle manière de concevoir le monde. C’est comme si « la nature » était soudainement dotée d’une volonté propre. La « nature » fait des choix. Bien sûr, ce sont ces « choix » faits par la nature qui deviendront, à partir de là, l’objet des observations scientifiques. Cela aboutira, au terme, à l’idée que ce qui est fixe dans l’univers, ce ne sont pas les choses, mais les lois qui les gouvernent.
Bien sûr, l’idée de donner, plus ou moins consciemment, une certaine volonté d’agir à la nature, est une idée entièrement athée. C’est un nouvel anthropomorphisme qui remplace celui que contenaient les religions anciennes. Cet anthropomorphisme se maintiendra longuement, jusqu’à aujourd’hui. Sa présence la plus courante se retrouve dans tous les documentaires modernes où on affirme que « l’évolution a fait ceci ou cela ». On reprend le vieux concept de Darwin qui affirmait : « c’est comme si » la nature faisait des sélections au même titre que les éleveurs. Évidemment, ceux qui utilisent cet anthropomorphisme en sont rarement conscients. Et, très souvent, ce sont les mêmes personnes qui reprochent aux religions d’avoir créé Dieu à partir de figures anthropomorphiques.
Une meilleure compréhension du concept de « lois » dans les sciences devrait permettre de sortir de ce dialogue de sourds et de cet impasse qui, finalement, nous ramène à une nouvelle forme de « fixisme ».